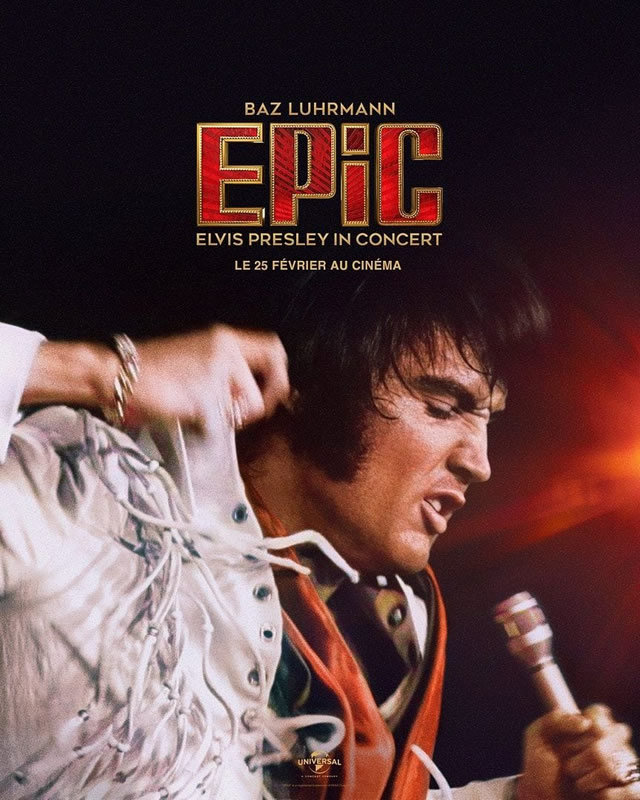Après une incursion brillante du côté d’Hollywood avec son époustouflant « Three Billboards », Martin MacDonagh effectue un retour aux sources et signe, certainement, son film le plus personnel. Épaulé par un scénario original-issu d’une trilogie- qu’il écrivit en 1999, et de son tandem porte-bonheur de « Bons baisers de Bruges », le réalisateur irlandais déploie une mécanique du pire sur un canevas scénaristique des plus ténus. 1923. Sur l’île d’Inisherin, Padraic apprend de la bouche de Colm, son meilleur ami, que leur connivence de longue date prend fin ( Colm jugeant sa fin proche et souhaitant se consacrer à des choses essentielles et non des futilités déblatérées chaque jour par son acolyte très « limité », Padraic). Incompréhension. Colère. Padraic cherche des explications, se renseigne auprès de sa sœur (épatante Kerry Condon), sur son intelligence, débat avec l’idiot du village (incroyable Dominic Kearney) puis supplie Colm de renouer avec lui. Au loin, la guerre civile semble s’essouffler.
Sur cette minuscule parcelle de terre habitable, où chaque habitant connaît son prochain, cette « trahison » prend des airs de drame shakespearien. Atteignant un point de non-retour et afin d’appuyer sa volonté, Colm commettra l’irréparable sur sa propre personne, plongeant la communauté dans l’hébétude et la résignation.
Ce n’est pas pour rien que je cite le Grand William. Cette tragédie du quotidien, parabole ô combien pertinente sur le non-sens de nos vies, puise constamment du côté de « Macbeth ». La fameuse Banshee, annonciatrice de Mort, semble issue de la dite pièce et le décor dans lequel elle évolue n’est pas sans rappeler l’adaptation fantastique d’Orson Welles. De surcroît, la réalisation ample, les mouvements de caméras élégants et la musique majestueuse signée Carter Burwell soulignent le caractère minuscule, universel et ridicule de cette triste anecdote sans jamais forcer le trait. Bien au contraire. Loin de verser dans l’hommage maladroit à ses illustres pairs ou à la comédie noire so british et attendue, Martin McDonagh ajoute à son édifice théâtral une pincée de surréalisme cher à Beckett. A quoi rime cette chanson? A quoi rime cet aller-retour constant entre lutte fratricide et épanchement amical? Joutes verbales saillantes et désarroi abyssal? A quoi rime ce désir de disparition sans raison?
En l’espace de deux heures, Inisherin se substitue au théâtre de nos existences et à sa friabilité. A l’incongruité des secondes qui s’égrènent, avec une économie de moyens surprenante à l’heure du tout numérique.
Pour donner forme à cette mésaventure statique, il fallait un duo d’exception. Mission accomplie. Colin Farrell (auréolé de la Coupe Volpi pour son interprétation), bluffant en candide effaré, et Brendan Gleeson, ours mal léché à tendance dépressive, imprègnent l’écran de leur présence magnétique. Mieux, ils offrent au public une performance nuancée où les silences et les non-dits importent plus que les coups d’éclat. Laurel et Hardy sous influence Buster Keaton (qui tonne?), leur désamour nous soulève le cœur autant qu’il nous agace. Et nous renvoie à notre propre condition humaine. Fourmis œuvrant pour le bien commun dans un automatisme chronophage et cannibale. Se raccrochant au lien social comme à une bouée de sauvetage. Foule sentimentale. Tout(e) seul(e). tout le temps.
Hâtez-vous de voir cette œuvre diablement originale (et produite par la Fox!), intelligente et d’une profonde délicatesse.
A n’en pas douter, ce voyage en terre irlandaise vous subjuguera longtemps après son visionnage et vous laissera en bouche une amertume digne… d’une Guinness.
John Book.