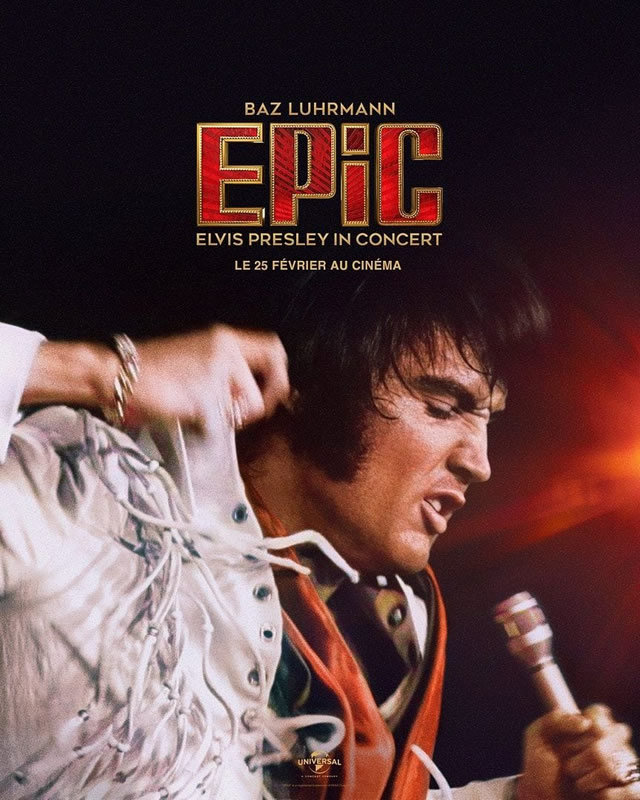Retour sur une absence prononcée et une incompréhension de taille. 1989. Nous sommes en pleine vague blockbuster. Les soldats de « Glory » croisent les élèves d’un professeur facétieux, John Woo dégaine les colts et un certain James Cameron plonge en eaux troubles. C’est dans cet éventail de sujets « hors-norme » et de longs-métrages monstrueux, tandis que les années 80 balbutient leurs derniers jours, qu’un réalisateur américain allait redéfinir le paysage cinématographique mondial et redonner ses lettres de noblesse au Film Noir.
John Dahl.
Premier coup de semonce et coup de maitre avec « Kill Me Again » et son couple glamour à souhait. John Dahl puise aussi bien dans « Bonnie and Clyde » que dans « Guet-apens », la violence en sourdine et le sex-appeal pour tout oriflamme.
En véritable amoureux du film de genre et du polar ténébreux, Mister Dahl s’ingénie à élaborer des scénarios complexes et savamment dosés.
Action, séduction, attraction, désastre. Chez notre scénariste américain, tout n’est qu’affaire de coup tordu et d’impasse amoureuse.
Encouragé par des critiques élogieuses et un regain d’amour du public pour les couples mythiques à l’écran (Bacall & Bogart, inévitablement), il passe la seconde et nous offre, dès 1992 le (red)nec plus ultra en matière de descente aux Enfers.
D’entrée de jeu, le ton est donné. Un générique sonore digne de Chris Isaak, une bagnole échouée près d’une route déserte et un pied poussant-avec difficulté- la porte latérale. Nicolas Cage fait son apparition et c’est la pellicule qui se calcine. Bras tatoué, gueule en vrac, l’acteur réinvente une décontraction déjà portée par Steve Mc Queen, sans se forcer.
Il faudrait inventer un terme précis pour définir la « perte de contrôle maitrisée » au théâtre. Une recherche si intense que l’acteur cèderait la place, le temps d’une représentation ou d’un tournage, à un autre que lui-même, instantanément, sans filet. Où le rire sardonique qui s’échapperait de la bouche de l’interprète flirterait avec celui de Richard III ou d’Hamlet. Où les nombreux personnages en jachère dans sa cage thoracique prendraient la tangente tous azimuts. Une possession digne de l' »Exorciste », me diriez-vous ? Oui mais sans effets de manche ou spéciaux. Ici, Stanislavski se substituerait au Diable. Acting total. Une page blanche prête à toutes les ratures mais, aussi, tous les élans poétiques. Un univers de possibilités où le jeu en retrait alternerait avec une débauche d’émotions réduite à quelques secondes. Coup de sang puis sang-froid.
Sur la brèche.
Ce terme précis, je l’ai déjà sur le bord des lèvres : « Joue-la comme Nick ! ».
Use de ton charme et explose de manière impromptue. Déstabilise tes partenaires. Souffle le chaud et l’effroi. Mélange les extrêmes.
ON/OFF. FUCK OFF.
Porte une veste en peau de serpent. Avale des litres de whisky. Arrache-toi de l’asphalte à bord d’une ambulance ou d’une moto enflammée.
Embrasse. Embrase.
Brûle mais…
« Joue-la comme Nick ! ».
Au large de ses futures élucubrations et de son « acting » survolté, Nick Cage adopte, ici, une sobriété propre à l’élégance de John Dahl. Quitte à endosser les habits de Mr John Doe. Car dans ce « Red Rock West » d’anthologie, c’est tout un pan de l’histoire du thriller dans le 7ème art qui est convoqué. A savoir Cary Grant chez Hitchcock et sa « Mort aux trousses », « Les Forbans de la Nuit » de Jules Dassin ou, plus proche, Dennis Quaid dans le remake de » Mort à l’arrivée » d’Annabel Jankel et Rocky Morton.
Un anti-héros face à un piège inextricable.
Au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, la loi de l’emmerdement maximal.
Dans ce bouquet choisi, on y distingue cette même appétence pour les tempos mesurés et les échanges de coups de feu modérés. Un même choix de réalisation loin des montages frénétiques.
Héritage ?

John Dahl est « old school » et fier de l’être. Ses maitres sont, sans aucun doute, Robert Aldrich ou Howard Hawks. Son atout ? Sa distribution, toujours flamboyante. Son point fort ? Une intrigue en spirale qui nous mène vers une issue inexorable.
Classe. Efficacité. Morale.
Telle est sa recette gagnante, pourtant connue. Tel est son credo.
Mais revenons, justement, à « Red Rock West » et la partition de Nicolas Cage.
Car, il faut bien l’admettre, on ne peut qu’être fasciné par cet équilibre entre violence retenue et figure désabusée.
Big Nick aurait pu figurer dans une chanson de Springsteen ou Willie Nelson.
Cow-boy Marlboro. Cœur pris au lasso. Il est le gars du coin, un peu plus « more than life » que le voisin. Voir cet acteur s’épanouir au sein d’un carcan prédéfini (le film noir) est un bonheur de cinéphile. Son Golden Globe et Oscar du meilleur acteur-en 1996- pour « Leaving Las Vegas » sonnera comme une évidence. Cage est immense, gargantuesque et ubuesque. Un Dieu (son fils se nomme Kal-El !) prêt à tous les dérapages. Need for Speed. On the Rocks.
Face à cet électron libre, Lara Flyne Boyle défend, du mieux qu’elle peut, un personnage de femme fatale grossièrement dessiné. Pourtant douée (sa beauté froide sert parfaitement Donna Hayward dans la série « Twin Peaks » ou le culotté « Threesome » d’Andrew Fleming), son jeu semble corseté dans un immobilisme gênant. Ou est-ce un contrepoint voulu par le réalisateur ? Ce dernier ne reproduira, d’ailleurs, pas la même erreur, offrant deux ans plus tard, le visage d’une parfaite mante religieuse à Linda Fiorentino dans l’excellent « Last Seduction ».
J.T. Walsh, second rôle de talent, (« Hannah et ses soeurs » de Woody Allen, « Good Morning, Vietnam » de Barry Levinson ou « Les arnaqueurs » de Stephen Frears), compose un salopard de premier ordre avec délectation.
Enfin, le cultissime Dennis Hopper (je ne vous ferai pas l’affront de dérouler sa filmographie hétéroclite et impressionnante) s’amuse à dynamiter-avec panache ! – le cliché du tueur à gages en le dotant d’un humour décalé. Une figure de style qu’il répétera à satiété au sein des 90’s, que ce soit dans « Speed » de Jan de Bont ou le submersible « Waterworld » de Kevin Reynolds.
Tous ces éléments conjugués font de ce « Red Rock West » un thriller qu’il est bon de redécouvrir séance tenante.
N’ayant pas convaincu la critique avec « Une virée en enfer » ou « You kill me », John Dahl s’est, depuis, réinventé en réalisateur télé.
Injustice.
On lui souhaite un retour imminent dans les salles obscures, les bons polars (en 2021 : « Une affaire de détails » de John Lee Hancock) se faisant de plus en plus rares (2022 : « The Batman » de Matt Reeves).
Pour reprendre Eddy Mitchell :
» Ça commence comm’ dans un film noir
Un jeune couple embarqué dans un’ sal’ histoire
P’tits voleurs, fichés et recherchés
La vie les a changés
En marginaux blessé. »
Sur un écran géant, c’est tout ce que je souhaite retrouver.
Et pour le reste ?
Que Dahl !
John Book.