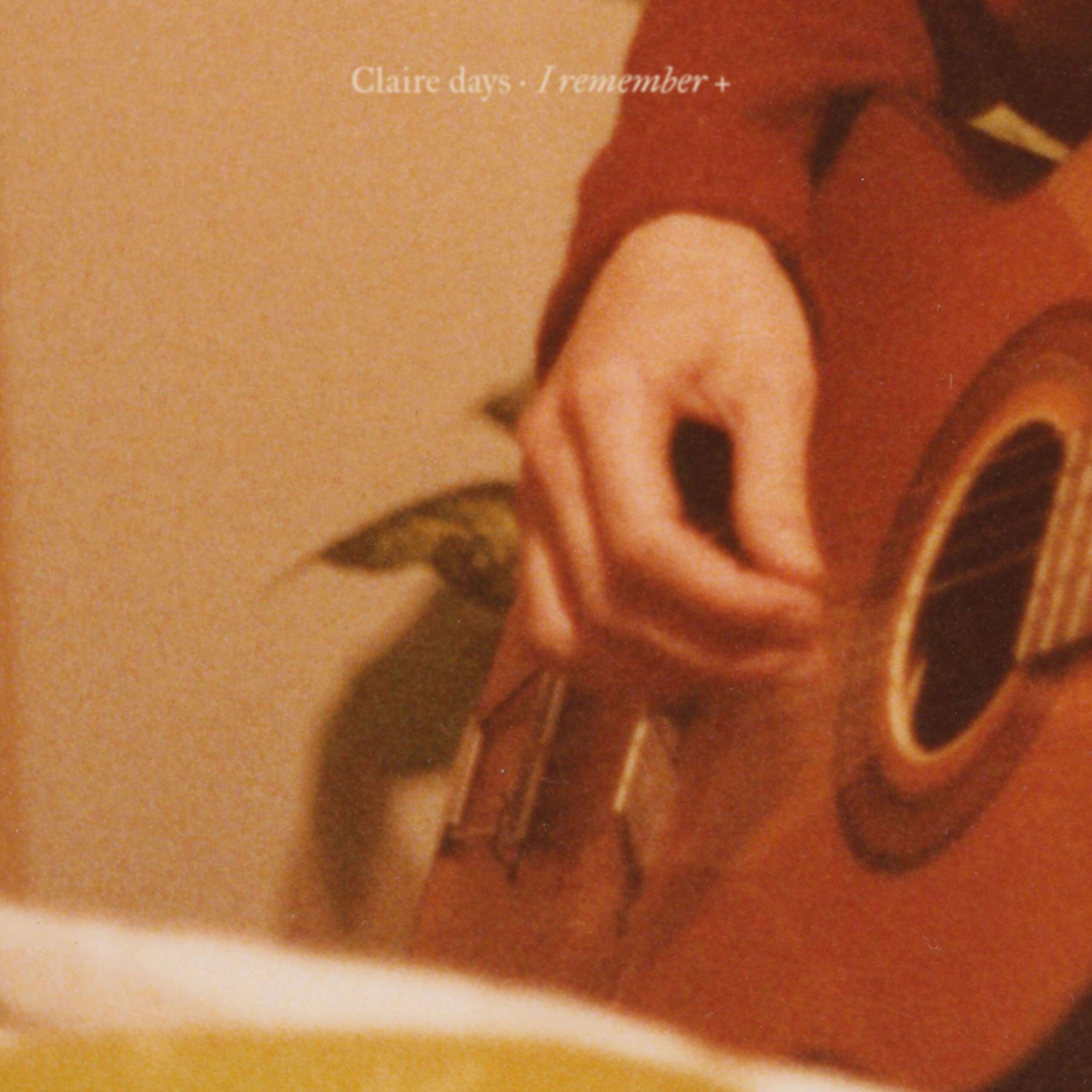C’est entendu, Hollywood aime casser ses jouets. Que ce soit à base d’intra-terrestres belliqueux envahissant le monde, de tornades rugissantes au sein de champs de maïs ou d’une météorite zigzaguant dangereusement vers notre atmosphère, les producteurs de blockbusters affectionnent-de longue date- les dégâts des eaux et les effets dévastateurs. « Le météore de la Nuit » de Jack Arnold, « La Tour Infernale » de John Guillermin et Irwin Allen, « Daylight » de Rob Cohen, « Alerte ! » et « En pleine Tempête » de Wolfgang Petersen, « Armageddon » de Michael Bay, « Le Pic de Dante » de Roger Donaldson, « La Guerre des Mondes » de Steven Spielberg ou « Twister » de Jan de Bont, tous s’accordent à molester l’humanité et notre environnement l’espace de deux heures. C’est dans cette grande tradition (et entreprise de démolition) que se positionne « Greenland » de Ric Roman Waugh, long-métrage sorti cet été 2020 en plein semi-déconfinement et bénéficiant d’un contexte pour le moins évocateur.

Serait-ce la fin du Monde ? N’y aurait-il plus aucune porte de sortie ? Aucune voie salutaire ?
Non, mes Ami(e)s, cette fois-ci les carottes sont cuites. Une comète et sa multitude de débris s’approchent à une vitesse vertigineuse de notre planète Terre et nous n’avons plus que 48 heures pour faire nos bagages, nos prières et vider notre compte en banque.
La bande-annonce promettait un B-Movie d’envergure. Quelques mois plus tard, à l’abri dans mon salon, je fus agréablement surpris de découvrir un « film de genre » misant tout sur les conséquences de ce coup du sort… et non une débauche outrancière d’effets spéciaux antédiluviens.
C’est dans cette retenue bienvenue que le film gagne ses galons de divertissement intelligent. Michael Bay et ses avalanches en fusion repasseront. Ici, seul l’Humain est au premier plan. Et de tous les plans.
Le canevas scénaristique est, certes, convenu (un couple séparé-avec enfant au beau milieu- se rabibochera au fur et à mesure que le cataclysme annoncé prendra de l’ampleur) mais l’on décèle, au détour d’un enjeu narratif, la critique d’une Amérique privilégiant plus ses nantis que ses « anti« . A savoir que celles et ceux qui seront à même de pouvoir rebâtir une société en perdition (de par leurs fonctions et leurs spécificités hauts placées) jouiront d’un privilège absolu : l’assurance de leur survie. La middle-class sera, donc, remisée à la casse avec la plus basse. Point de vue intéressant pour une « grosse machine » lorsque l’on se penche rétrospectivement sur la politique répressive de Donald Trump. Hollywood virerait-elle démocrate ? Ou se rachèterait-elle une conscience purement démagogique ? Toujours est-il que le message pour les masses est passé.
Autre point positif et non négligeable : son casting. Gerard Butler, depuis son avènement dans « 300 », joue à présent les gros bras nonchalants sans jamais tomber dans la caricature. Héros ordinaire privilégiant l’instinct de conservation à la baston, cet architecte esseulé est interprété avec conviction et distance nécessaire.
Less is More.

Seules importent sa résistance et sa réactivité face aux éléments déchainés.
Malmené sur les réseaux sociaux pour sa carrière en dents de scie, Gérard Butler avait pourtant trouvé le « rôle de sa vie » dans l’étourdissant « Criminal Squad » de Christian Gudegast. Flic borderline porté sur le whisky, les biceps tatoués et doté d’une gueule ravinée, Big Nick O’Brien imposait un personnage inoubliable du haut de ses 1 mètre 88 sans se forcer. La brutalité à fleur de peau mais chialant dans sa caisse à l’annonce d’une garde d’enfants révolue, Mister Butler promettait une carrière moins calibrée. Hélas, le film fut accueilli tièdement et sa prestation gargantuesque oubliée.
Pour « GreenLand« , cette carcasse sensible soigne son retour et s’octroie des alliés de premier choix. Dotée d’une plastique superbe, Morena Baccarin, partenaire au jeu « sensitif » aperçue dans la série « HomeLand« , « FireFly » et son épilogue « Serenity » se distingue de ses consœurs par ses qualités d’incarnation sans pose ni hypersexualisation.
Alliant sensibilité et force de caractère, son personnage d’Allison Garrity (maitresse de maison guerrière et ordinaire) frôle le cliché sans jamais y sombrer. Un sauvetage permanent par l’entremise d’un jeu « naturel, « sur le fil » et sans filet…que bon nombre d’actrices factices devraient prendre en exemple.
King Bach et David Denman, éblouissants, livrent des compositions affolantes dignes de premiers rôles et nous remuent de l’intérieur.
Enfin, comble d’extase pour tou(te)s cinéphiles qui se respectent, l’immense Scott Glenn illumine de sa présence inquiétante un final quasi-irrémédiable. Mémoire vivante du Cinéma Américain avec, à son actif, une filmographie somptueuse (« Apocalypse Now« , « American Graffiti« , « L’étoffe des Héros », « Silverado« , « A la poursuite d’Octobre Rouge« , « Le Silence des Agneaux« , « Training Day » ou l’incandescente série « DareDevil« , entre autres…), cet immense acteur fait, de nouveau, rimer rigueur avec grandeur. Et pousse « Greenland » vers des rivages émotionnels de toute beauté.
Malheureusement, Hollywood ne peut s’empêcher de réparer ses jouets. Ainsi, alors que les dernières minutes du film se cristallisent dans une réalité amère, une fin alternative succède à la première, privant définitivement « Greenland » d’un statut de série B culte.
Nous rêvions d’une impasse à la « Arlington Road« , nous nous contenterons d’une ode à la reconstruction version « Gravity« .
Mais ne boudons pas notre plaisir !
A l’heure où les salles de cinéma se substituent à des cimetières d’éléphants et des dernières séances, ce long-métrage riche en secousses telluriques nous aide à patienter jusqu’à leurs ouvertures imminentes…et signe, l’air de rien, un avant-goût de « Top Gun Maverick« !?
John Book.