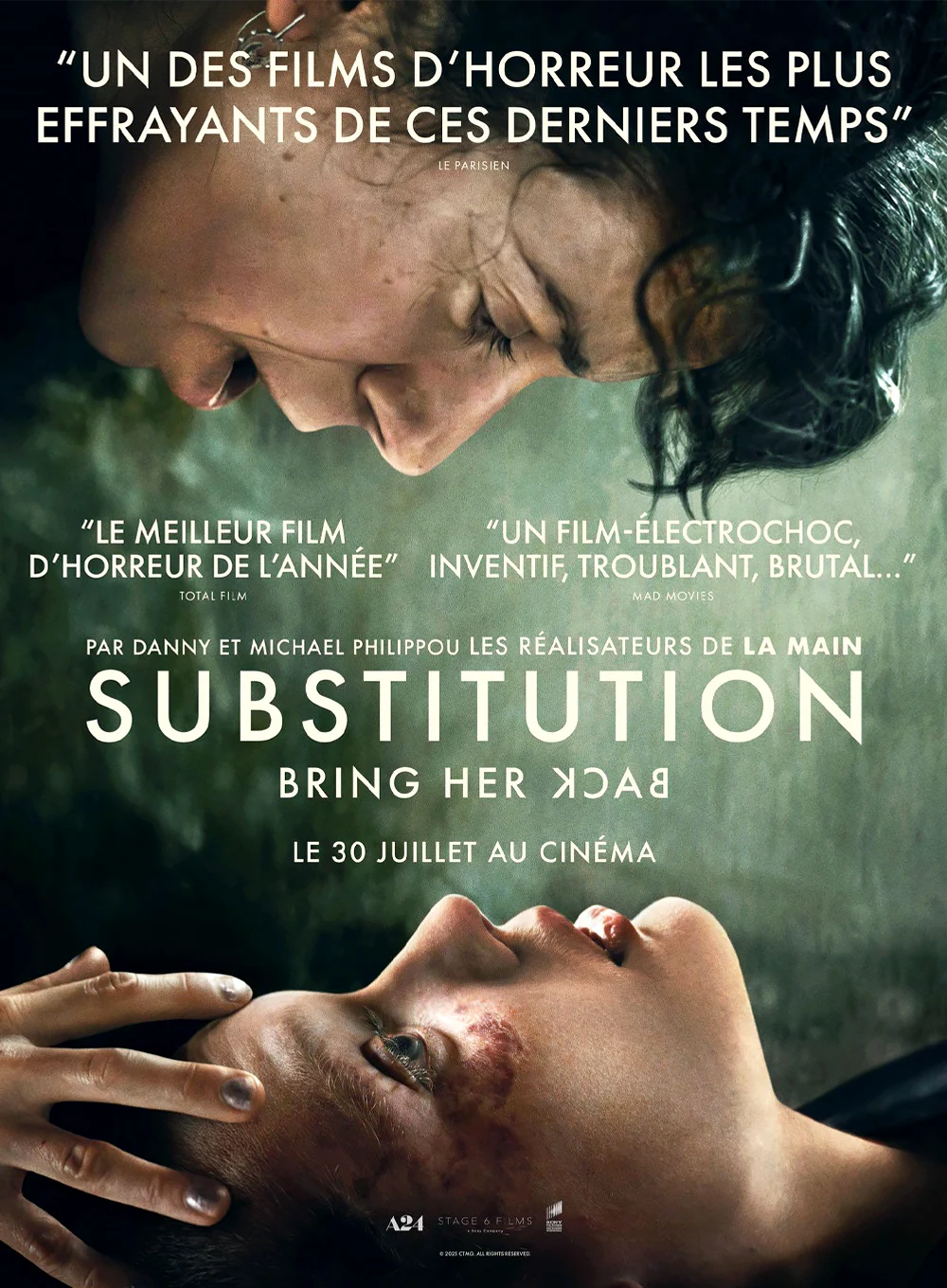« Bonjour et Bonne Année, messieurs-dames, bon, je vous dis cela, ça ne mange pas de pain… »
« Dis donc, il ne draine pas les foules, Jim… »
« Oui mais un jeudi après-midi, à 14h00, c’est normal… »
Effectivement, nous sommes sept pèlerins dans la minuscule salle de projection de mon cinéma de quartier et je suis certainement le plus jeune parmi le public. Le silence règne dans l’attente de ce mystérieux » Father, Mother, Sister, Brother ». Fébrilité. Big Jim allait-il nous décevoir ? Un excellent casting est-il fatalement synonyme de réussite ? Et, surtout, depuis sept ans d’absence, qu’allait pouvoir apporter à son moulin l’Ami Américain ?
« The Dead don’t Die » m’avait laissé un goût d’inachevé. S’emparer du film de genre en brisant constamment le quatrième mur ? Bravo, voici un pari gonflé. Malheureusement, Brecht à la sauce Romero avec ce zest de nonchalance qui caractérise si bien notre cinéaste…comment dire ? Nous fûmes catapultés aux antipodes du brillant « Paterson » en matière de comédie douce-amère. Échec aimable.
Rassurez-vous, pour son quatorzième opus, Jarmusch renoue, avec brio, avec l’excellence et s’inspire aussi bien de « Broken Flowers » pour ses portraits en pointillé que de « The limits of control » pour ses moments « en creux ».
Qu’est ce qui nous relie à notre famille et nos parents ? Sommes-nous redevables d’une naissance/existence au sein de l’Humanité ? Le mensonge est-il la seule voie possible face au caractère intrusif d’une discussion, somme toute badine, entre une mère et sa fille ? Prenons-nous toute la mesure de l’importance d’une filiation lorsqu’un décès survient ?
C’est en trois tableaux que Jim Jarmusch tente d’esquisser une réponse.
Le premier, désarmant, mise sur le « vide » en terre américaine. Les personnages incarnés par Mayim Bialik et Adam Driver, rejetons pétris de culpabilité et d’incompréhension, rendent visite à leur vieux père. Ce dernier (Tom Waits, parfait) s’englue dans une maison bordélique et usée, s’empêtre dans des phrases toutes faites, des clichés sur le quotidien ou la teneur qualitative d’une eau minérale. Pitié. Embarras. Ennui. Effet boomerang nous renvoyant à des souvenirs de repas dominicaux interminables où rien ne se joue et rien ne se dévoile. Passe-moi le sel (de la discussion). Jusqu’à ce que…
Le deuxième volet, lui, nous emmène en Irlande au sein d’une demeure so british. Luxe, calme et volupté. Chaque objet est à sa place. Chaque pièce délicatement ordonnée et soignée. Petite forteresse nimbée de naphtaline où règne en maitresse de maison Charlotte Rampling (d’une élégance folle), impassible dans l’attente de ses deux filles. L’une (Vicky Krieps, pétillante) est une ado attardée dont le nombril semble être sa seule obsession. L’autre (Cate Blanchett, enlaidie et étonnante) ne vit que dans le regard et l’approbation de sa mère. Trio terne et bancal qui, le temps d’un goûter, reprend des couleurs…puis sombre dans une spirale de questions-réponses. Ainsi, le château de cartes vacille. La cordialité prend des allures d’interrogatoire et de bilan annuel. Les non-dits se cachent sous la table et le temps se disloque. Jusqu’à ce que…
Enfin, le dernier chapitre aborde le deuil dans notre capitale. Deux jumeaux, Skye et Billy (incarnés avec sensibilité par Indya Moore et Luka Sabatt) vouvoient les fantômes de leurs parents dans un appartement vide et débarrassé de toutes réminiscences « tangibles ». Abasourdis par l’absurdité de la vie, notre duo s’accroche aux lambeaux d’un monde révolu. Vestiges du passé dans une coquille vide. Tristesse insondable. Mais Billy réserve une surprise de taille à sa sœur sous les traits d’une enveloppe fournie. Synchronicité du binôme. Dialogues en Ping -Pong. Jusqu’à ce que…
Pour magnifier ces instants de grâce, Jim Jarmusch déroule son savoir-faire dans les grandes largeurs. Peu de travellings. Des fonds bleus (utilisés comme des chausse-trapes visuelles lors de répliques épiques en automobile), de nombreux « plans séquence » immobiles ou l’utilisation de plans « en plongée » pour ausculter un plan de table (plan évoquant l’intro hypnotique de « Only Lovers left Alive ») sont, ici, convoqués et les ombres d’Ozu, Dreyer ou Antonioni invoquées.
C’est certainement le plus beau long-métrage de notre réalisateur francophile. En vieillissant, l’Homme en Noir délaisse ses saillies rock n’roll pour mieux s’interroger sur les effets d’un temps chronophage et cannibale. C’est avec une immense générosité qu’il laisse déployer le jeu de ses interprètes où chaque nuance, chaque étonnement ou balbutiement prend une importance fondamentale dans leurs joutes oratoires. Pour preuve, ce superbe dialogue où Billy apparait face à sa sœur dans l’embrasure d’une porte. Et de se lancer un « You’re Dead » simultané à la fois comique et terriblement poignant. Le septuagénaire n’en oublie pas ses gimmicks pour autant et je vous laisse le plaisir de retrouver ses pastilles affectueuses disséminées çà et là. Salutations adressées à ses potes du Wu Tang au détour d’un déménagement, running gag dont le ressort comique n’est autre qu’une montre ou expressions surréalistes concernant un certain Bob, tout converge vers un humour surréaliste dont la poésie feutrée n’est plus à démontrée. Jim Jarmusch ou la politesse du désespoir…
Je suis sorti de la séance heureux et profondément ému. Bouleversé par le propos universel de ces tranches de vie.
» Father, Mother, Sister, Brother » est produit, en partie, par Saint Laurent et a obtenu le Lion d’Or à la Mostra de Venise.
Vous l’aurez compris.
Le dernier Jarmusch conjugue classe absolue et rigueur visuelle avec une simplicité confondante.
La marque des plus grands ?
Bien évidemment.
John Book.
.