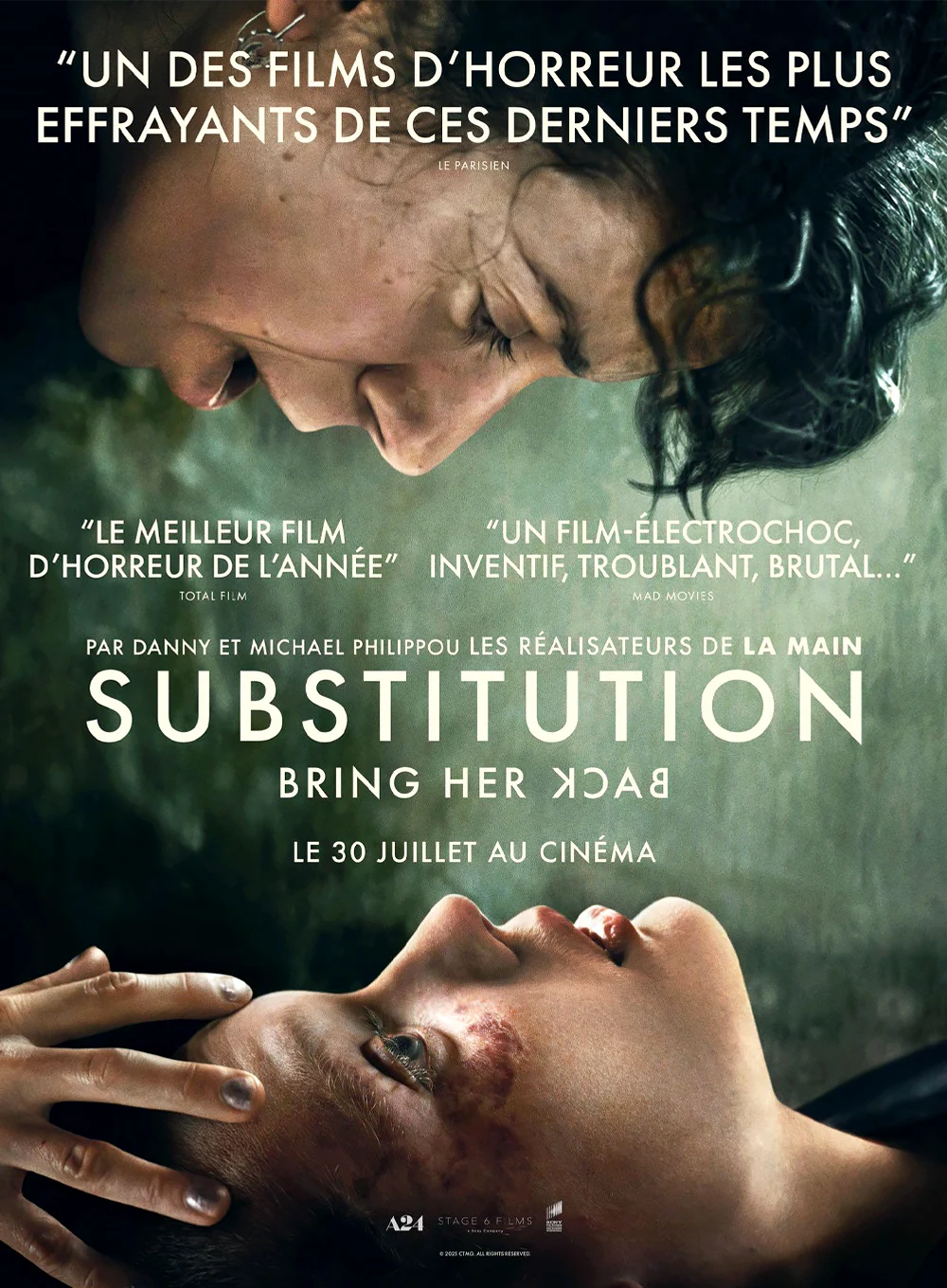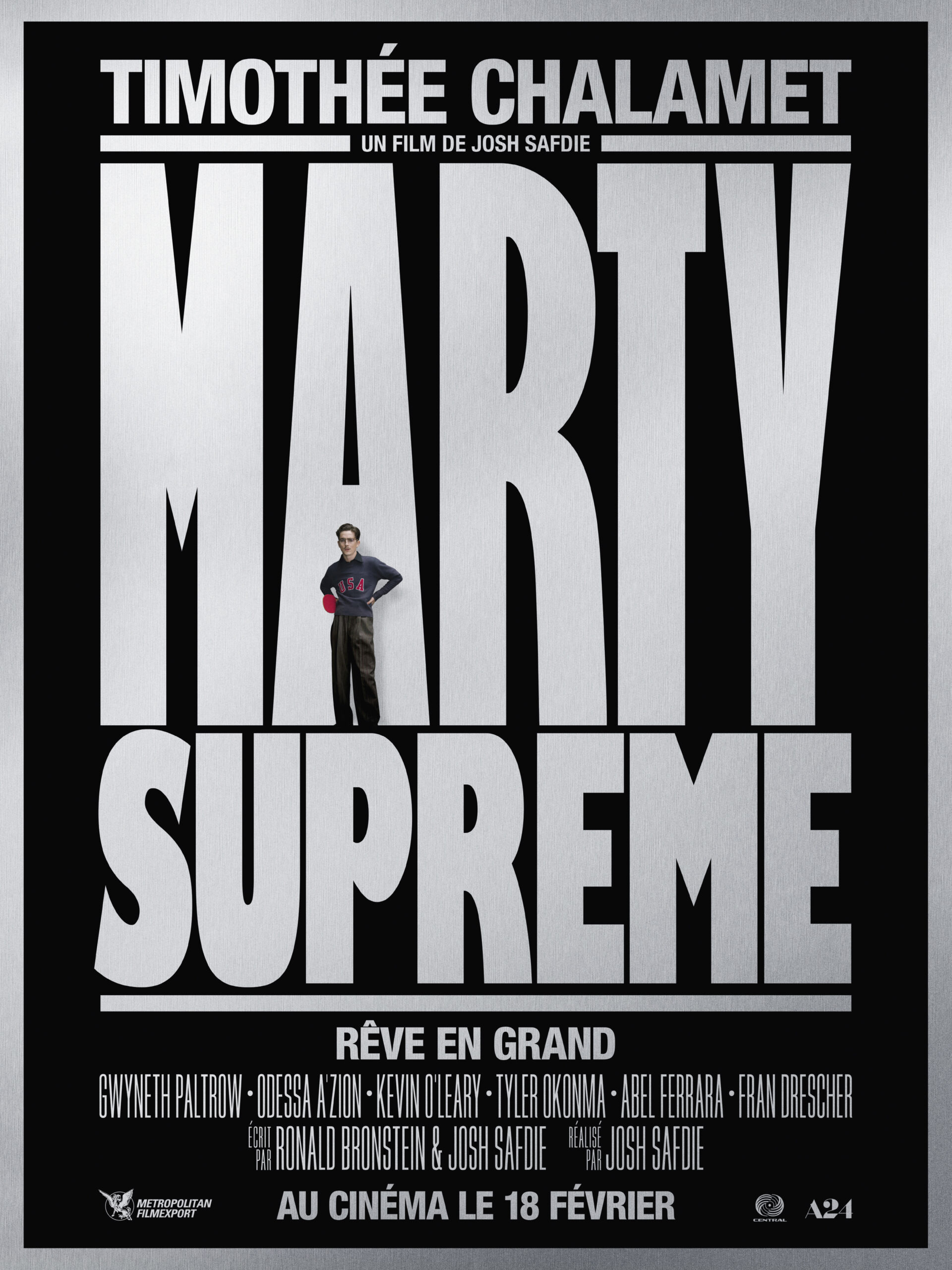Il est étonnant de constater à quel point le Cinéma inspire, dans un même espace-temps, nos réalisateurs. Après « Babylon » de Damien Chazelle et « The Fabelmans » de Steven Spielberg, c’est au tour de Sam Mendes de déclarer sa flamme au 7ème Art et , plus précisément, au temple qui le met en exergue: la salle de projection. Cette grande différence le distingue de ses prédécesseurs. Ici, point d’état des lieux d’un Hollywood-Vampire ou d’une vocation précoce pour le métier de cinéaste. Le réalisateur de « 1917 » chérit les salles obscures et tout le protocole qui l’accompagne. Devanture électrique, photos glamours, grand hall d’accueil au charme suranné et placeurs/placeuses à l’entrée. Nous sommes en 1981, dans une station balnéaire anglaise, et l’heure est à la mutation sociale. Le producteur des « Sentiers de la perdition » délaisse, ainsi, le polar pour faire place à la chronique amoureuse sur fond de montée du racisme.
Pour cela, il s’épaule d’un scénario simple et solide: la rencontre inopinée entre une ouvreuse dépressive quadragénaire et d’un étudiant noir de vingt ans au sein d’un cadre professionnel atypique.
Nos deux tourtereaux verront leur Amour malmené par un patron adipeux, des skinheads bas du front (pléonasme), l’état mental précaire de notre bouleversante protagoniste et devront faire face à la bêtise, qu’elle soit tapie dans un siège de direction ou le regard réprobateur d’une société engoncée dans ses préjugés.
La bande-annonce promettait une romance sociale digne de Douglas Sirk (ou de « Loin du paradis » de Todd Haynes) mais, au final, c’est beaucoup plus que cela.
En auscultant le microcosme d’une équipe disparate-épatante distribution!- mais dévouée à l’accueil de son public, Sam Mendes dresse le portrait d’une nation britannique en proie à des troubles économiques. Lorsque l’illusion d’un monde meilleur se cristallise au sein de bobines de films, le cinéma fait office de cocon soyeux face à l’ère Thatcher, le chômage, la pauvreté et l’exclusion. Car dehors, la jeunesse issue de l’immigration est désignée comme coupable idéal et lutte pour sa survie. Ainsi, »Empire of Light » joue sur plusieurs tableaux.
La photographie terne d’une décennie naissante d’un côté, le romantisme exacerbé d’un couple bancal de l’autre. Et au milieu? Un écran géant où tous les rêves sont permis.
Entre ces trois forces contradictoires, l’équilibre de ce long-métrage se fait sans une fausse note. Mister Mendes paufine ses mouvements de caméras, opte pour le classicisme (tel le papa de « Pentagone Papers ») et donne toute latitude à son chef-opérateur ( Roger Deakins, déjà à l’œuvre sur le fantastique « Blade Runner 2049 »).
Sur le plateau, Olivia Colman ( impressionnante dans « The Father », « The Lobster » ou encore « La Favorite »), Micheal Ward (repéré dans la série » The A List »), Toby Jones ( annoncé dans « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée » et dont la filmographie donne le tournis) et l’impeccable Colin Firth (doit-on encore le présenter?) prouvent, une fois de plus, que l’école d’enseignement théâtral britannique est insubmersible en matière d’acting. Enfin, la bande-son hypnotique et feutrée d’Atticus Ross et Trent Reznor sublime les élans brisés de nos deux sentimentaux sans en rajouter.
Mesurée mais d’une élégance folle, la filmographie de Sam Mendes possède la classe d’un James Bond. Ses opus-comme autant de futurs classiques intemporels- en attestent.
Le plus bel hommage que l’on puisse, donc, rendre à sa dernière production est d’aller la voir, séance tenante…dans une salle de cinéma!
John Book.