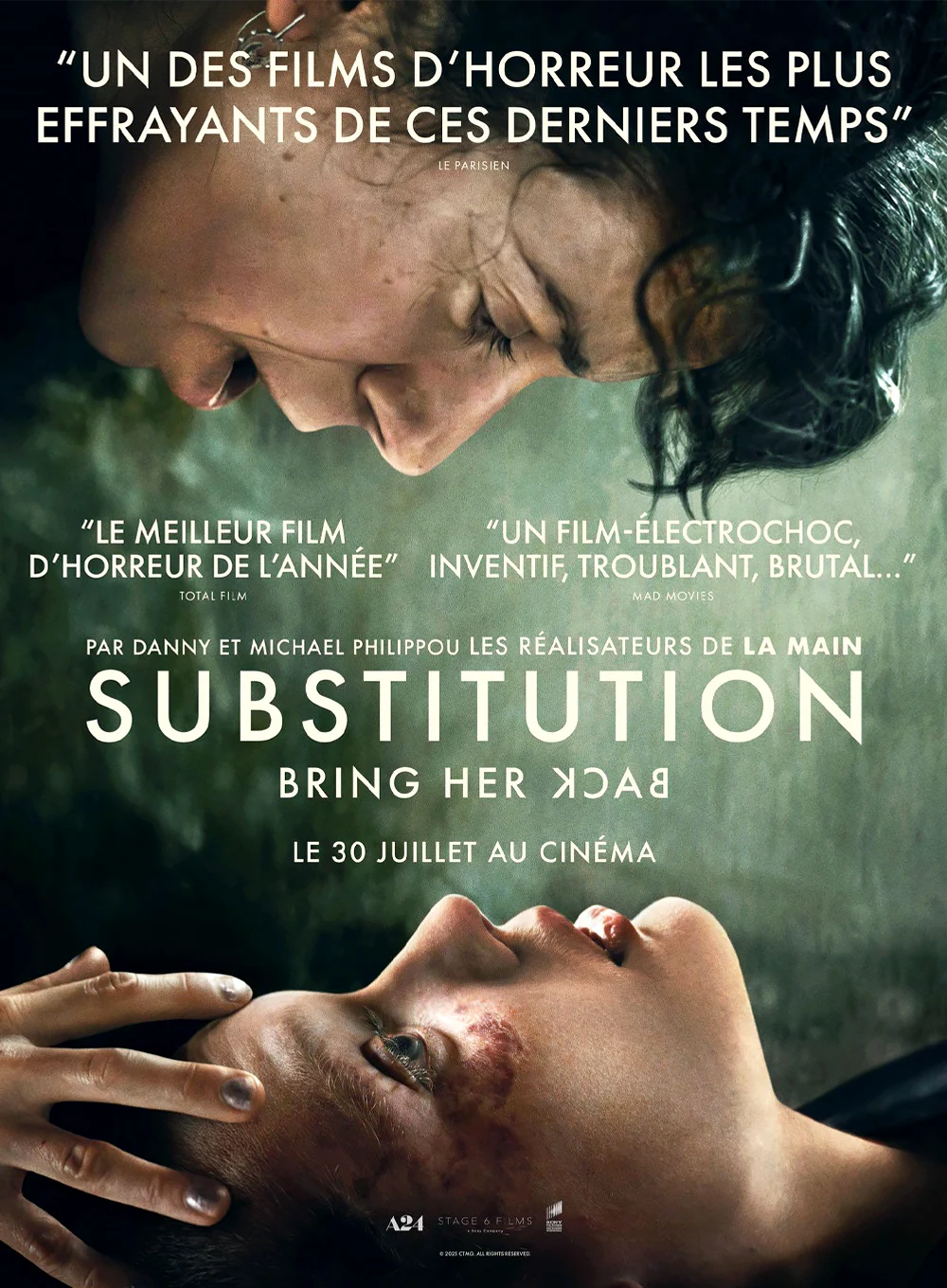Un paradis, en apparence. Des couleurs franches, un horizon calme, presque rassurant. Puis, à y regarder de plus près, les grands espaces et l’absence. Quelque chose de fracture, de fort comme l’innocence du vivant. « Death in Paradise », le nouvel album de Full Moon Little House, commence là : dans cette fissure entre la beauté et ce qu’elle dissimule par pudeur. Chez FMLH, rien n’est jamais purement sombre ou lumineux. C’est l’art du contraste que les mélodies accueillent, puis dérivent vers l’inconnu. Les textures s’étirent, se superposent, délirent. Une douceur s’installe, bientôt traversée par un trouble discret, souterrain. Comme un souvenir qui refait surface sans prévenir, familier et pourtant insaisissable. La musique devient paysage mental, espace de projection, zone grise entre réconfort et vertige.
Projet de Kévin Navizet, musicien et graphiste, Full Moon Little House pense le son comme une image et l’image comme une émotion. Influencé par le nu-prog, le post-rock et les écritures cinématographiques, « Death in Paradise » se déploie en scènes sonores, loin des formats prévisibles, évoquant le rock progressif d’Archive ou le shoegaze Stereolab. Un disque habité par l’ambiguïté, où l’épure côtoie la distorsion, où l’efficacité pop flirte avec des structures mouvantes, toujours en tension.
Pensé comme une expérience à vivre plus qu’un simple album à écouter, « Death in Paradise » trouve son prolongement naturel sur scène, là où la musique ne se reproduit pas mais s’amplifie, se densifie, frappe autrement. À l’occasion de cette sortie, Kévin Navizet revient sur la genèse de cet album clair et troublant, et sur cette contradiction fertile qui en constitue le cœur battant.
.
Le titre Death in Paradise évoque une contradiction forte. D’où vient cette idée de tension entre beauté apparente et perte souterraine, et comment s’est-elle imposée comme fil conducteur de l’album ?
Il y a effectivement, dès le titre, un fil conducteur contradictoire sur cet album. Puis, à travers le visuel, on perçoit au premier regard quelque chose de coloré, presque joyeux, un paysage contemplatif. Mais si l’on regarde de plus près, ce paysage est en réalité vide, figé, presque glacial.
Avec ce titre et cette image, on est directement dans le sujet de l’album : cette opposition permanente qui le parcourt. À travers une contradiction, on peut faire naître énormément d’émotions.
Tu parles souvent de composer comme on construit une image. Concrètement, à quoi ressemble ton processus de création : pars-tu d’une sensation visuelle, d’une texture sonore, ou d’une narration intérieure ?
Tout est transversal. Composer de la musique, composer une image ou même composer un bouquet de fleurs, c’est finalement la même chose : trouver un mouvement, une dynamique, une émotion, à partir de ton ressenti et de ta manière de voir les choses.
Quand j’écoute une musique que j’aime, je l’associe instinctivement à des couleurs, des formes, parfois même des odeurs ou des souvenirs. Tout est lié. En général, je pars d’une mélodie forte autour de laquelle je vais bâtir un univers : des textures, des images, des ressentis. Ces éléments me nourrissent en retour et me font rebondir vers de nouvelles idées.
Je teste beaucoup. Si une mélodie me semble trop convenue, je vais chercher à la détourner, à la rendre plus singulière, souvent par l’expérimentation sonore.
Le projet FMLH est né du désir de faire dialoguer musique et image. Quelle place tient aujourd’hui ton regard de graphiste dans l’écriture musicale et dans la mise en scène du live ?
Les deux sont totalement liés. La pochette de l’album est, pour moi, une synthèse de la musique qu’on y trouve. Comme je suis quelqu’un de très visuel, le graphisme et l’image m’ont ouvert énormément de possibilités dans la musique.
C’est un peu comme un peintre qui ferait des essais de couleurs sur une palette, sauf qu’ici ces tests sont transposés au son. Cette approche influence autant l’écriture que la mise en scène du live.
Entre Funeral et Death in Paradise, on sent une évolution vers un nu-prog plus pop et électro. Est-ce une transformation naturelle ou un virage conscient dans ta manière de composer ?
Death in Paradise est le fruit d’une grosse réflexion autour de l’identité d’un album. Il y a eu un parti pris artistique clair, avec des choix assumés de formats et de structures.
À l’inverse, Funeral était plus un laboratoire, sans réelle ligne directrice : je composais sans contrainte. Ici, l’album a été structuré de manière consciente et réfléchie. Je cherchais une certaine efficacité de composition, avec des formats plus resserrés, tout en conservant l’essence du rock progressif et ses structures évolutives.
Je trouvais intéressant de condenser un savoir-faire prog dans des morceaux plus pop, et peut-être de susciter un certain étonnement chez l’auditeur.
Les morceaux jouent souvent sur des structures évolutives, lentes, parfois déstabilisantes. Comment trouves-tu l’équilibre entre expérimentation et efficacité émotionnelle ?
Je travaille en plusieurs phases. Je pars le plus souvent d’une mélodie simple mais forte, que je vais ensuite explorer et transformer. J’essaie de trouver un juste équilibre entre l’étonnement et cette sensation familière, presque rassurante : le côté “on se sent un peu comme à la maison”. Ça rejoint l’idée d’ambiguïté dont on parlait plus tôt. L’idée est de trouver la bonne mesure entre expérimentation et confort, pour envelopper l’auditeur dans un petit cocon, tout en l’emmenant ailleurs.
Tu évoques cet instant où une mélodie fait ressurgir un souvenir oublié. Est-ce que l’album est nourri de souvenirs personnels précis, ou plutôt d’émotions universelles que tu cherches à provoquer chez l’auditeur ?
Je pense être davantage dans la rêverie. J’ai été profondément touché par certaines musiques, et je le suis encore aujourd’hui. J’essaie simplement de retransmettre, à travers ma musique, ce qui a pu me toucher en tant qu’auditeur.
Il s’agit donc plutôt d’émotions universelles, au sens large, que chacun peut s’approprier selon son propre vécu. Ce ne sont pas des souvenirs précis ou des émotions personnelles clairement identifiables, même si l’album est évidemment nourri de ce qui m’a touché personnellement. Encore une fois, on retrouve cette forme d’ambiguïté.
Le projet reste volontairement en marge des formats traditionnels. Est-ce une posture artistique, politique, ou simplement la conséquence naturelle de ta manière de créer ?
C’est quelque chose de très naturel. Je ne pourrais pas vraiment faire autrement. J’ai été nourri par une multitude de groupes très différents, chacun avec sa propre identité, donc je fais simplement la musique que j’aime, sans me fixer de limites ni chercher à coller à un son “hype”.
Je suis aussi quelqu’un d’assez instable, et j’aime quand ça bouge. Il est d’ailleurs très probable que les prochaines productions reviennent à des formats beaucoup plus longs, simplement parce que j’en ai envie.
Le travail collectif avec les autres musiciens semble central. Comment s’articule la composition à plusieurs sur Death in Paradise, et qu’apporte chacun à l’identité sonore de FMLH ?
Jusqu’à présent, je propose des maquettes assez poussées et relativement finalisées, qui sont ensuite adaptées au live. Chaque musicien peut alors se réapproprier ses parties.
Sur Death in Paradise, deux compositions ne sont pas de moi. The Reach a été entièrement composée par Yan, le bassiste. Un jour, il m’a dit : “J’ai écrit ce morceau pour Full Moon.” J’ai tout de suite accroché.
Il y a aussi Kings in the Haze, composé par Stef. À l’origine, c’était un morceau instrumental assez long, que j’ai réadapté dans un format plus court, en écrivant les paroles. Là encore, il y avait des mélodies très fortes qui m’ont vraiment touché, donc le morceau avait naturellement sa place sur l’album.
Les autres titres sont restés assez proches de mes propositions initiales, mais tout l’intérêt réside dans l’adaptation et l’énergie du live.
Tu décris le live comme une amplification plutôt qu’une reproduction du disque. Qu’est-ce qui change concrètement sur scène, et que souhaites-tu faire ressentir différemment au public ?
Je déteste assister à un concert où j’ai l’impression d’écouter l’album tel quel. Si je vais voir un groupe en live, c’est pour vivre quelque chose de différent, une émotion supplémentaire, voire plus forte qu’à l’écoute du disque.
C’est vraiment la finalité du projet : apporter une plus-value, plus de relief, aller plus loin dans le propos. En concert, il y a cette part d’instantané, d’indescriptible, qui n’existe qu’une seule fois à chaque date. Il y a quelque chose de presque sacré.
Quand je parle d’amplification, j’entends un live qui te chamboule profondément. C’est clairement mon objectif.
.
Photo de couv. Gregory Perrochon