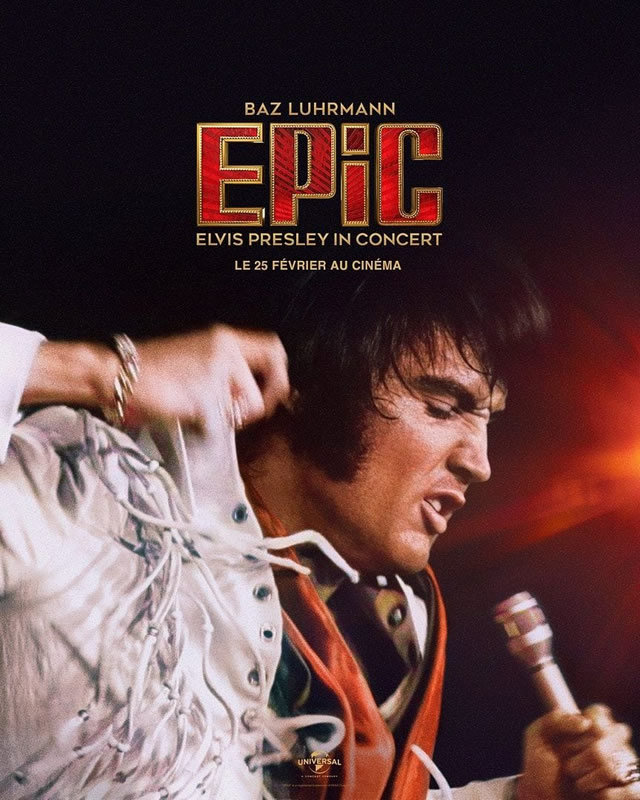une course effrénée entre la peur et la beauté brute
Une musique qui décrit pas un monde détruit, puis le reconstruit en fracas. Avec Rabbit Run, le quintet de Bristol revient en terrain miné, armé d’une intensité brute, d’un instinct primal, et d’une conscience poétique toujours à vif. Exit la tendresse texturée de TANGK, retour à une urgence tendue comme un muscle qui refuse de se détendre. Ce nouveau titre, premier fragment de la bande originale du film Caught Stealing de Darren Aronofsky (sortie prévue le 29 août 2025), est plus qu’une chanson : c’est une échappée. Un râle. Une trajectoire floue entre l’instinct de fuite et le besoin d’exister.
Moteur, action, déraillement
Dès les premières secondes, Rabbit Run plante le décor : batterie motorik, basse vrombissante, guitare scindée entre tension métallique et élégance dissonante. C’est une mécanique qui claque, grince, et file sans avertissement. La rythmique, droite comme une ligne de coke, propulse le morceau dans un univers où l’homme ne court plus pour survivre, mais parce que s’arrêter signifierait s’effondrer. C’est un tour de vis sonore, une traînée de poudre encadrée par une production plus sobre que sur TANGK, mais tout aussi affûtée.
Joe Talbot, de sa voix fêlée et incantatoire, n’interprète pas : il transpire, halète, incarne. Les paroles ? Presque improvisées, selon certaines sources. Et pourtant, chaque mot semble jaillir du fond des tripes comme une vérité trop longtemps contenue. Il ne s’agit plus de construire des slogans ou des aphorismes : il s’agit de dire. Dire ce qui déborde, ce qui éclate, ce qui court.
Le cinéma au bout des ongles
Si IDLES a toujours flirté avec la dramaturgie (ne serait-ce que par leur tension scénique viscérale), Rabbit Run pousse cette fusion à un autre niveau. Pensée comme une extension sonore de l’univers d’Aronofsky — maître des corps en souffrance et des esprits fragmentés — la chanson semble presque écrite dans la pellicule. Elle n’illustre pas une scène : elle la hante. Elle devance l’image, en épouse la violence sous-jacente.
Aronofsky filme souvent des personnages en chute libre. IDLES leur offre ici une bande-son à hauteur d’os. Ce n’est pas du rock à écouter, c’est du rock à vivre — ou à fuir.
Une esthétique de la panique
Dans un monde saturé d’artifices et d’intellectualisations molles, IDLES continue de faire l’éloge du corps en transe, de la colère incarnée, de cette brutalité belle qui jaillit quand le vernis social craque. Rabbit Run évoque l’époque Brutalism, mais sans nostalgie. On y retrouve ce mélange de nihilisme et de tendresse, ce refus d’abdiquer, même dans la laideur.
Les guitares râpent, les silences deviennent vertiges, et la composition, pourtant minimaliste, garde une densité émotionnelle rare. Le morceau tient moins d’un single que d’un uppercut poétique, un de ces gestes instinctifs qui précèdent la réflexion — comme un cri dans un tunnel, sans assurance qu’il y aura un écho.
Et si on grattait sous la croûte ?
Les réactions sont partagées. Certains saluent le retour d’une rage plus primitive, plus crue, plus efficace. D’autres y voient une perte de repères, une fuite en avant sans direction claire. Mais peut-être est-ce là tout l’intérêt : Rabbit Run n’est pas un manifeste, ni une profession de foi. C’est une dérive contrôlée, un élan de fuite transformé en acte artistique.
Et si, finalement, ce morceau était le miroir fidèle de notre époque ? Une époque confuse, rapide, violente, où l’on court sans toujours savoir pourquoi, mais avec une urgence qui, elle, ne trompe jamais.