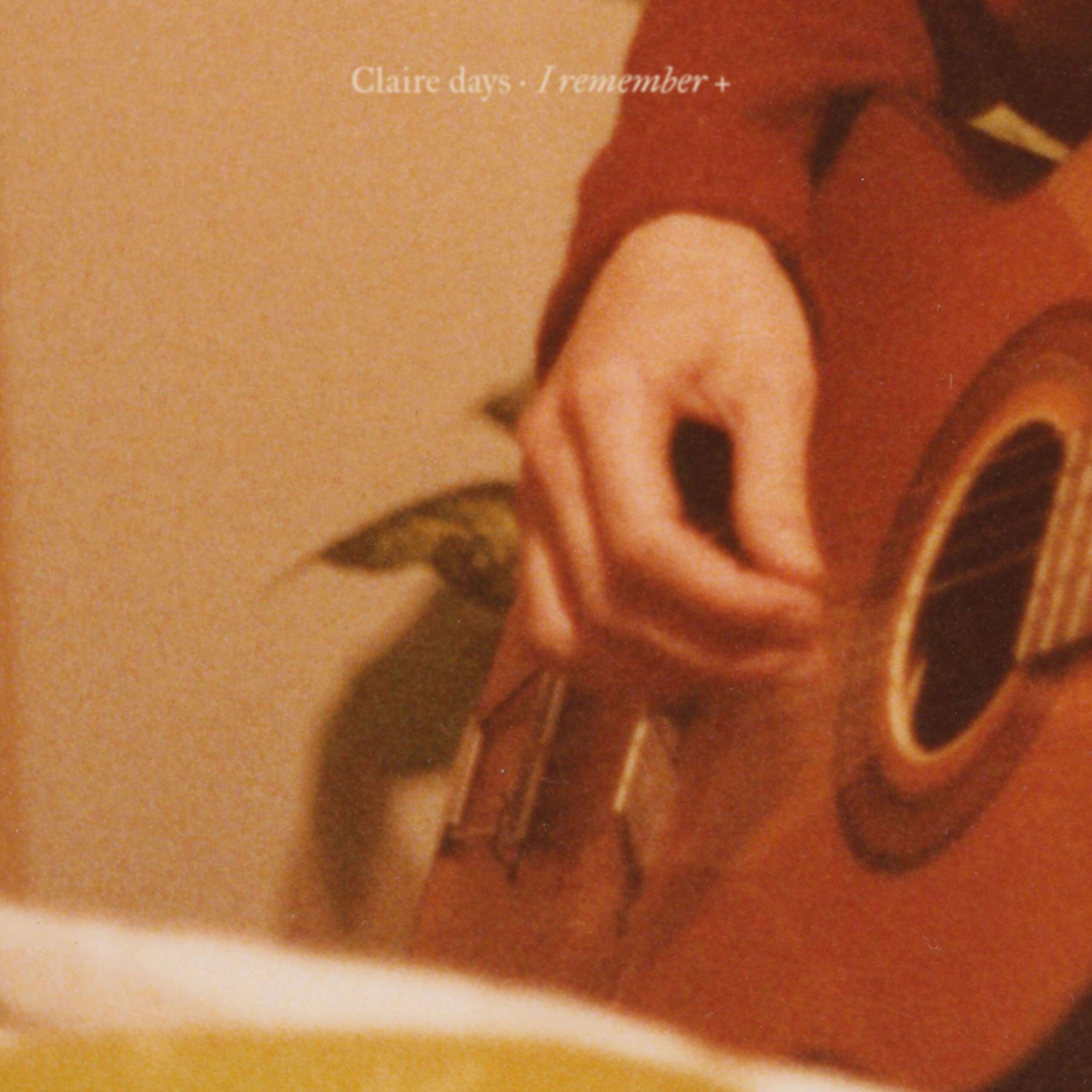Figure discrète mais essentielle de la scène rennaise, Sébastien Thoreux, que l’on croise autant derrière ses guitares dans Talio que dans les marges les plus aventureuses de la pop locale, revient à son projet le plus intime : Wonderboy. Plus de dix ans après un premier passage marquant aux Trans Musicales, l’artiste ressuscite cette identité née dans la solitude d’un appartement parisien, armé d’une boîte à rythmes vintage et d’un goût prononcé pour les textures sonores atypiques.
Avec « Death of a Drum Machine », album conçu presque entièrement en solitaire, Wonderboy dévoile une synthèse sensible de ses obsessions entre Brian Eno, Bowie et LCD Soundsystem, la liberté totale des années 70 et le plaisir de laisser les machines respirer, transpirer.
À l’occasion de la sortie de ce disque aussi personnel qu’exigeant, nous avons discuté avec Sébastien Thoreux de solitude créative, d’influences tentaculaires, de musique qui se fabrique toute seule… et de ce que signifie, aujourd’hui, remettre en lumière un projet aussi profondément ancré dans l’intime.
Pour commencer, peux-tu revenir sur les origines du projet Wonderboy ?
Wonderboy est né à Paris, à une période où j’étais très solitaire. Je venais d’arriver dans la région et je n’avais pas encore de cercle musical, j’ai dû me réinventer. Après un concert de Beck, j’ai découvert l’univers des boîtes à rythmes. J’en ai acheté une, une vieille machine trouvée sur eBay, et ça m’a ouvert une nouvelle porte pour pouvoir composer seul, enregistrer avec un simple 4 pistes cassette et écrire sans contraintes.
C’était un projet très minimaliste. Style un musicien dans son appart qui veut malgré tout faire de la musique.
Si je ne me trompe pas, ce projet remonte à plusieurs années déjà, non ?
Oui, j’ai commencé autour de 2007-2008, j’avais 25 ans.
Et ensuite, quand j’ai quitté Paris pour m’installer à Rennes, j’ai rejoint le groupe Republik grâce à Frank Darcel. Là, j’ai rencontré Florian Pardigon et Kévin Toublant, qui m’ont encouragé à reformer Wonderboy, mais en groupe. Kévin a transmis une démo à Jean-Louis Brossard, ce qui m’a valu une première date solo à l’Ubu, puis la tournée des Trans Musicales en 2011.
Ce passage aux Trans t’a permis de solidifier le projet ?
Oui, ça lui a donné de la visibilité, mais ça n’a pas débouché sur un label ou un album. Ça restait assez confidentiel.
Tu as joué dans d’autres groupes depuis. Qu’est-ce qui t’a décidé à revenir à Wonderboy autant d’années plus tard ?
Les autres groupes comme Republik ou les Wankin’Noodles étaient formateurs, mais j’y étais sideman. Wonderboy, lui, est profondément personnel : j’écris, je chante, je produis selon ma sensibilité.
Avec Tally Ho!, auquel je participe toujours, je compose pour un ensemble ; il y a une direction collective. Wonderboy, c’est l’endroit où je peux plonger dans quelque chose de plus intime.
Ce côté personnel est-il libérateur ? Permet-il d’exprimer des choses impossibles ailleurs ?
Oui, clairement. Pendant la covid, j’ai beaucoup composé pour Tally Ho!, mais certaines chansons risquaient de dormir dans un coin. Avec Wonderboy, j’ai pris le temps d’écrire des textes, d’explorer des textures sonores, des effets de guitare. J’ai pu expérimenter sans contraintes.
Et je sentais que ce que je créais avait le potentiel de parler à d’autres.
Et comment réagissent les personnes de ton entourage qui connaissent ton travail ?
On m’a toujours encouragé à faire du Wonderboy. Mais le projet a souvent été difficile à faire vivre : vies familiales, boulots, dispo des musiciens, etc.
Je suis exigeant, et parfois, face aux difficultés, je me réfugiais dans Tally Ho!, où tout est plus simple.
Mais Wonderboy a ce petit quelque chose que les gens aiment : une musique pas compliquée, mais avec une profondeur, des instruments parfois insolites, une mise en scène vive grâce à Florian à la batterie et aux différentes personnes qui rejoignent le projet.
Comment définirais-tu l’ADN de Wonderboy ?
C’est paradoxal : même si la création est très individualiste, je me projette toujours sur scène avec un groupe. Wonderboy, c’est un objet que moi seul peux tenir, mais que d’autres peuvent venir éclairer avec moi.
Sur scène, un groupe donne une dimension ludique et spectaculaire qui me plaît énormément.
Tu cites dans tes influences musicales Brian Eno. Comment son style s’est-il imposé ?
Je fais du télétravail, donc j’écoute beaucoup de musique toute la journée et, en effet, la musique de Brian Eno m’aide à me concentrer, mais au-delà de ça, son univers me parle énormément.
Je suis aussi nourri de David Bowie, de LCD Soundsystem… Eno est derrière tous ces artistes-là.
J’aime son côté tentaculaire, ses arrangements, sa façon de casser les formats dans une musique qu’on fabrique dans une sorte de cocon.
Pour « Death of a Drum Machine« , j’ai voulu abandonner les structures couplets-refrains et chercher cette sensation que la musique fait d’elle-même.
Cette influence, elle te permet de construire aussi un peu ton univers ?
Je suis parti aux États-Unis pour jouer quelques concerts, et ce voyage m’a ouvert les yeux : en France, j’ai souvent l’impression d’être « l’Américain de service », parce que je compose et je travaille avec une approche très influencée par la musique américaine. Mais une fois là-bas, je me suis vite rendu compte que j’étais en réalité « l’Européen de service ». (rire)
Sur scène, dans ma manière d’être, dans les morceaux que j’apportais, tout sonnait très européen, un peu trop intellectuel. Ça m’a vraiment amusé. J’ai compris alors que je ne serai jamais un Américain et ce n’est pas bien grave (rire).
C’est aussi ce que j’aime chez Brian Eno. Il a façonné une identité musicale européenne forte dans les années 70, entre ses collaborations avec Bowie ou les musiciens allemands. Et il reste encore incroyablement pertinent aujourd’hui.
Pour l’album, j’ai voulu m’inscrire dans cette filiation, et ne pas choisir la facilité. S’inspirer d’Eno, c’est accepter de sortir des formats classiques, de créer quelque chose d’ouvert, d’inattendu.
Avec Wonderboy, j’ai essayé de faire la même chose…
Avec qui as-tu travaillé pour concevoir cet album ?
J’ai fait appel à Mikey Young (Eddy Current Suppression Ring, Total Control, Melbourne) pour le mix et le mastering.
Au début, mon album était une bouillie sonore enregistrée au casque, très lo-fi. Mikey a compris ce que je voulais faire et m’a aidé à épurer, à rendre le tout plus lisible.
Au final, j’ai réduit de 12 à 9 titres pour renforcer encore la cohérence.
Partager quelque chose d’aussi personnel avec quelqu’un que je ne connaissais pas, et qui me valide, ça m’a fait du bien.
Comment t’es-tu senti une fois l’album finalisé ?
Je suis du genre à vouloir toujours plus, j’imaginais un double album !
Mais avec du recul, je me dis que ces 9 titres sont exactement ce qu’il fallait.
L’homogénéité fonctionne et les premiers retours le confirment.
Aujourd’hui, je pense qu’il vaut mieux sortir plus d’albums, comme dans les années 60, plutôt que de vouloir mettre trop dans un seul.
Sortir un album physique aujourd’hui, c’est aussi marquer une étape.
Oui, surtout que j’avais un peu abandonné l’idée d’un album solo pendant un temps.
Entre un enfant, un label qui n’avait pas pu défendre mon précédent disque, et des projets collectifs difficiles à fédérer, j’avais laissé Wonderboy de côté.
Cet album, c’est un retour : une façon de montrer ce qu’il y a dans ma tête, d’aller enfin au bout.