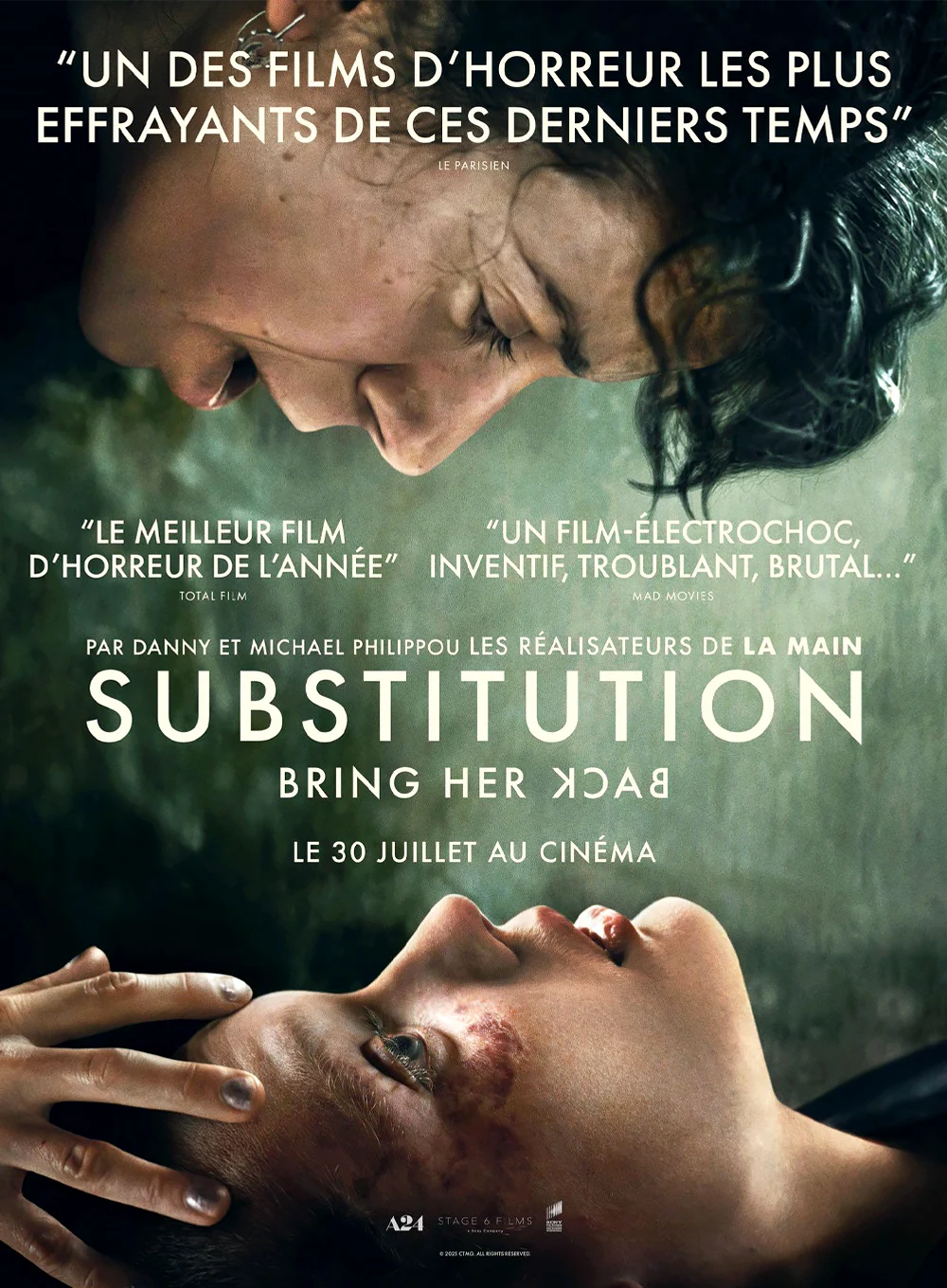Après plusieurs années d’attente, Computers Kill People revient avec The Storyteller, un album qui marque une nouvelle étape dans l’histoire du groupe. Plus dense, plus mature, plus ambitieux aussi, ce disque confirme la métamorphose entamée depuis leurs derniers EPs. Finis les errements adolescents et l’énergie parfois trop brute de la première période : le combo parisien affirme ici un rock puissant et ciselé, quelque part entre la mélodie frontale d’un Foo Fighters et la noirceur industrielle d’un Nine Inch Nails, tout en gardant ce groove lourd et implacable qui est devenu leur marque de fabrique.
« The Storyteller » surprend d’abord par sa cohérence. Malgré une gestation étalée sur plusieurs années, les morceaux semblent taillés d’un même bloc, portés par une production nerveuse et un sens de l’efficacité rarement pris en défaut. Les riffs y sont massifs mais jamais écrasants, les refrains accrochent sans céder à la facilité, et les textes plus narratifs, plus engagés témoignent d’un groupe qui regarde enfin le monde autour de lui, pleine d’inquiétude, de lucidité et d’une ironie mordante. Du groove inquiet de « Good Guy With a Gun » au chaos atmosphérique de « The End », en passant par une reprise excellente et totalement réinventée des Red Hot Chili Peppers, l’album raconte autant l’époque qu’il raconte ceux qui le jouent.
Au cœur de cette évolution, il y a Loïc, guitariste-chanteur et fondateur du groupe, qui semble avoir trouvé dans cette formation stabilisée une manière plus collective, plus libre d’écrire et de composer. À l’occasion de la sortie de l’album et de leur retour sur scène, il revient avec nous sur la genèse de « The Storyteller », l’alchimie du groupe, leurs choix esthétiques et leurs nouvelles ambitions.
Pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur l’origine du groupe, sa formation et le sens du projet ?
À l’origine, le groupe remonte à une vingtaine d’années, si je remonte vraiment à la forme primitive du projet. Mais sa forme actuelle, ou en tout cas celle qui s’en rapproche le plus, date plutôt de 2012. Bien sûr, il y a eu des changements de line-up entre-temps, mais l’envie de départ était de faire un rock plus lourd, plus dense que ce que je faisais dans mes groupes précédents.
Et la formation actuelle s’est construite comment ?
Ça s’est fait progressivement, mais la vraie stabilité est arrivée quand notre bassiste, Karin, a rejoint le groupe. À ce moment-là, on a trouvé une cohésion qu’on avait toujours cherchée : quatre personnes avec les mêmes envies musicales et la même énergie. Avant, il y avait toujours un léger décalage. L’arrivée de Karin a vraiment débloqué l’alchimie. La formation actuelle existe depuis cinq ou six ans.
Le son du groupe a pas mal évolué. Aujourd’hui vous êtes plutôt sur un stoner rock mélodieux. Est-ce que la nouvelle formation, et Karin en particulier, a renforcé votre envie d’aller vers cette esthétique ?L’envie d’aller vers quelque chose de plus lourd et de plus mature existait déjà avant l’arrivée de Karin. On l’a ressentie dès 2015, après la sortie de Silence Means Security. On avait l’impression d’avoir atteint un palier, et j’avais envie d’arrêter les chansons “écrites dans mon coin”, très adolescentes, pour aller vers un rock plus affirmé, quelque part entre Foo Fighters et Nine Inch Nails, et un peu moins du côté Queens of the Stone Age, Kyuss ou Monster Magnet.
Sur votre dernier album, vous reprenez un titre des Red Hot Chili Peppers. C’est un choix assez inattendu. Est-ce que les Red Hot font partie de vos influences ?
Comme beaucoup de gens de notre génération, on a énormément écouté les Red Hot. Blood Sugar Sex Magik est un album culte pour moi. Leur groove n’est pas nécessairement une influence majeure, mais dans notre recherche de riffs efficaces et un peu groovy, il y a une filiation.
La reprise venait surtout de l’envie de choisir un morceau qui ne nous ressemblait pas forcément, qu’on adore, et de voir si on pouvait se l’approprier.
Parlons du nouvel album. Qu’est-ce qui a déclenché son écriture, surtout après autant d’années depuis le précédent ?
À la base, on voulait sortir trois EP et les rassembler ensuite en album. On en a sorti deux, mais avant d’attaquer le troisième, on s’est rendu compte qu’on avait beaucoup de nouveaux morceaux et qu’il serait plus intéressant de faire un album cohérent.
J’avais en tête depuis longtemps le titre The Storyteller. Après la sortie de l’EP Destruction Derby en 2020, post-Covid, on s’est dit qu’il était temps de tout réunir et d’aller au bout.
La cohérence de l’album s’est imposée naturellement ?
Pas vraiment, puisque les morceaux ont été écrits sur une longue période et dans des états d’esprit différents. Mais ils partageaient une énergie, une sonorité commune, et surtout des thématiques.
Au moment de créer la tracklist, on s’est concentré sur l’idée d’un ensemble qui raconte quelque chose – d’où The Storyteller. Sans qu’on s’en rende compte, nos textes s’étaient politisés : on parlait de thèmes plus larges que les malaises adolescents. Ça remonte déjà à 2015 avec Amnesia Dead, l’un de nos premiers titres à sortir de l’introspection pure.
Vos textes ont aujourd’hui une dimension narrative, parfois engagée. Qu’est-ce qui a nourri cette évolution ?
Déjà, le monde ne s’est pas vraiment amélioré ces dix dernières années… Et nous avons vieilli, on est devenus parents. On s’inquiète davantage du monde qu’on laissera derrière nous.
Des titres comme Good Guy With a Gun parlent d’un sujet qui n’est pas directement français, mais qui reste universel : la fascination pour les armes et la manière dont certains justifient leur circulation.
Et puis il y a The End, TV Monster… Ce sont des morceaux qui parlent de notre époque, de ce qu’elle a d’angoissant, d’absurde parfois.
Beaucoup de groupes français intègrent aujourd’hui du français ou d’autres langues. Vous, vous restez sur l’anglais. Pourquoi ?
Pour nous, chanter en anglais a toujours été une évidence, presque instinctive. Le rock est une musique profondément liée à la langue anglaise : ses sonorités, ses rythmes, sa manière de construire des phrases.
Le message est peut-être moins accessible au public francophone non anglophone, mais c’est une langue qui nous permet de nous exprimer naturellement.
Et honnêtement, je trouve que le français se prête assez mal au style qu’on fait. Il y a des exceptions, évidemment, mais dans notre esthétique, c’était un choix naturel.
On ressent une plus grande richesse dans les arrangements. Est-ce lié à votre évolution musicale ?C’est paradoxal, parce que nous avons eu le sentiment d’écrire des morceaux plus simples et plus directs que par le passé. Mais le fait que l’écriture soit aujourd’hui vraiment collective change beaucoup de choses.
Avant, j’arrivais souvent avec un morceau presque terminé. Maintenant, l’un de nous propose une idée et on construit ensemble. Dans les crédits, on s’est d’ailleurs partagé l’écriture à 25 % chacun. Ça contribue sûrement à cette impression de richesse et de complexité.
Avec qui avez-vous travaillé pour l’enregistrement et le mastering ?
On a quasiment tout enregistré nous-mêmes dans notre studio à Paris. Mais je n’étais pas satisfait des voix, alors on s’est tournés vers Étienne Sarthou, ex-batteur d’AqME, aujourd’hui dans Deliverance ou Freitot.
Étienne est exigeant sur les points techniques, mais il sait aussi laisser passer les “accidents heureux”, les prises où l’intention est parfaite même si tout n’est pas techniquement irréprochable.
Il a réenregistré toutes les voix, refait quelques guitares et basses, puis il a mixé l’ensemble.
Pour le mastering, on a travaillé avec Magnus Lindberg (Cult of Luna), un binôme qu’Étienne connaît très bien et avec lequel il a déjà beaucoup travaillé.
On m’a dit beaucoup de bien de vos concerts. Qu’est-ce que représente la scène pour vous ?
La scène, c’est notre raison d’être. Tout ce qu’on fait, même sortir des disques, c’est pour jouer en live. C’est là qu’on peut transmettre l’énergie, la libérer, la partager.
Chaque concert est un moment à part, et on donne tout, systématiquement.
Vous avez joué récemment au Supersonic pour accompagner la sortie de l’album. Comment avez-vous vécu cette soirée ?
C’était notre deuxième concert en dix jours, après une très belle release party à la Péniche Antipode.
Le Supersonic, c’est une salle très importante pour nous : on connaît l’équipe depuis toujours, et c’est aussi un endroit très personnel pour moi – j’y ai rencontré ma femme, je m’y suis marié…
Après deux ans et demi sans jouer, c’était un vrai retour à la maison. Et pour un lundi soir, la salle était pleine, ce qui nous a surpris et touchés. Une très belle soirée.