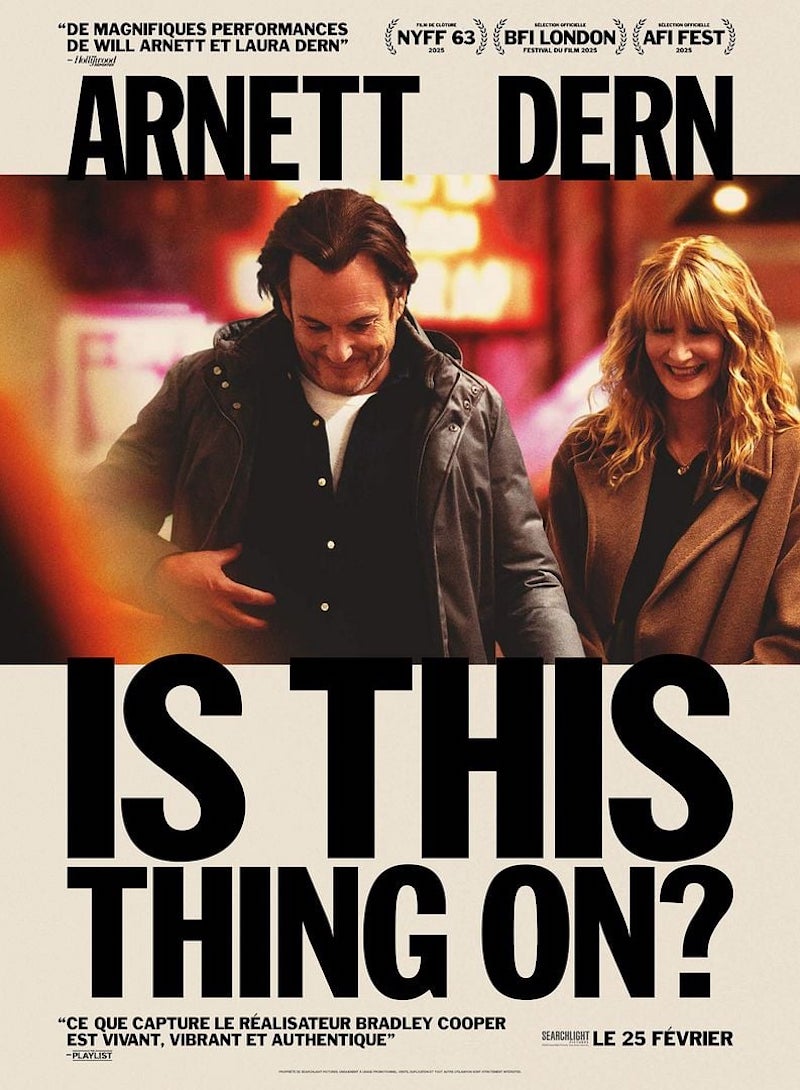Une affaire de famille.
Troisième film de tandem Grand Corps Malade et Mehdi Idir, “Monsieur Aznavour”, biopic autorisé du célèbre chanteur, emporte tout sur passage grâce à une prestation impeccable du comédien Tahar Rahim.
Avec “Patients” puis avec “La Vie Scolaire”, Fabien Marsaud, Grand Corps Malade à la scène, et son acolyte Mehdi Idir, ont montré leur savoir-faire en réalisant deux films à la fois drôles et touchants. Pour leur premier biopic, “Monsieur Aznavour”, on ne savait pas vraiment sur quel pied danser avant la projection. Allaient-t-ils tomber dans le pathétique larmoyant d’une vie d’épreuves éclipsées par des succès phénoménaux ou, au contraire, dans la facilité en transformant les 1h 51 du film en un gigantesque karaoké ?
Disons-le sans ambages, ils ne sont tombés dans aucun de ces deux pièges. Grâce sans doute beaucoup à Jean-Rachid alias Rachid Kallouche, l’un des quatre producteurs du film, compagnon de longue date de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir (il a produit leurs deux premiers films) et surtout mari de Katia, l’une des filles de Charles Aznavour. De quoi bien faciliter les choses et ouvrir grandes les portes de la famille aux deux metteurs en scène afin de réaliser un témoignage pour la postérité. « Nous sommes restés très fidèles à la vie de Charles » confirme Fabien Marsaud.
Tahar Rahim, ami des deux metteurs en scène, s’est également longuement investi pour son rôle inédit pour lui, celui d’un chanteur. Il a pris durant six mois des cours de chants et de piano afin de pouvoir maîtriser sur scène le temps des prises les chansons du maestro. Une performance bluffante et unique car le comédien ne se voit pas du tout chanteur ! « Pour nous, Tahar s’est imposé comme une évidence, souligne pourtant Fabien Marsaud. Nous savions, en regardant ses films, sa capacité de se transformer complétement. Nous lui avons proposé le rôle. Il nous a d’abord répondu que nous étions complétement “ouf” sans totalement fermer la porte. Et nous a rappelé pour nous dire qu’il était tenté et qu’il avait envie d’essayer. »
« Il me faisait rêver, voyager, il m’emportait »
Avant de rendre sa décision, le comédien s’est immergé durant un week-end dans l’univers du chanteur en visionnant de nombreuses images d’archives. Cela a suffi à le convaincre à relever un challenge jugé improbable au départ. « Charles Aznavour a toujours fait partie de ma vie, confie Tahar Rahim. Ses chansons ont bercé mon enfance, puis il m’a accompagné lorsque je suis arrivé à Paris, où je l’écoutais continuellement. Il me faisait rêver, voyager, il m’emportait. Il ne s’agissait pas d’imiter Charles Aznavour sous peine de tomber dans le burlesque mais jouer la ressemblance sans tomber dans le masque. Comme je l’avais déjà expérimenté sur d’autres films, j’ai proposé à Mehdi et Fabien de faire lire le script à une psychologue pour qu’elle nous livre son analyse de la psychologie du personnage. Cela nous a permis de mieux comprendre les névroses d’Aznavour, ses rapports avec sa famille, et surtout de désacraliser l’artiste et de le percevoir comme un être humain, avec ses forces et ses faiblesses.»
Parti-pris des réalisateurs, selon la volonté de Charles Aznavour, traiter surtout des années précédant le succès, celles de la galère pour ce petit chanteur limite malformé, hors des standards de l’époque et détruit par la critique. « Il nous a fallu tout lire, à commencer par ses deux autobiographies et les ouvrages journalistiques. Ecouter ses mille deux cents chansons, regarder tous les documentaires, toutes les interviews, puis effectuer un tri, détaille Fabien Marsaud. Pour les chansons, nous voulions qu’on puisse entendre ses classiques, mais aussi des titres moins connus. Nous avons aussi eu la chance d’avoir accès à ses archives et de pouvoir discuter avec ses proches et ses collaborateurs, qui nous ont tous fait confiance. Puis, nous avons établi la timeline de sa vie avec ses principaux événements. »
« Le constat d’une volonté hors-norme »
On s’en doute, les décisions ont dû être difficile à prendre. D’ailleurs, la partie cinéma de Charles Aznavour n’est qu’esquissée à travers un clin d’œil à “Tirez sur le pianiste” de François Truffaut tourné en 1960. « C’est un choix, explique Mehdi Idir. Charles Aznavour a tourné dans une cinquantaine de films, mais avec la densité de tout ce que nous souhaitions raconter, il a fallu trancher et synthétiser. “Tirez sur le pianiste” est le film le plus connu avec lui. Cette séquence est une évocation, Truffaut y incarnant le cinéma de manière symbolique. » Il poursuit : « La première version de notre scénario faisait plus de deux cents pages, soit un film de quatre heures ! Il nous a fallu élaguer, dégraisser, à l’écriture comme au montage, nous recentrer sur la substantifique moelle de son parcours et veiller à ce que ce récit soit rythmé. »
Les premières chansons entendues sont celles de Charles Trenet et des classiques de l’après-guerre. On découvre un enfant porté par une joyeuse famille d’artistes, des arméniens débarqués à Paris après avoir fui l’Allemagne nazie et un gamin espiègle mais rapidement porté par une grande ambition, celle de réussir dans la chanson. Quitte à se faire refaire le nez !
« Lorsque vous vous intéressez au parcours de Charles Aznavour, vous ne pouvez que faire le constat de cette volonté hors-norme, atteste Fabien Marsaud. Charles était fils d’apatrides, a connu la pauvreté, était petit de taille et avait la voix voilée. Malgré ces handicaps, il est rentré dans l’histoire de la chanson française. Il a su défoncer les portes fermées, ne pas tenir compte des critiques peu amènes à son égard, des propos racistes dont il était l’objet. C’était très violent !»
Charles a, petit, déjà tout pour connaître un destin hors du commun. Il est surtout, bien que démuni, très débrouillard. Sa volonté sans limite fera le reste. Avec son ami pianiste Pierre Roche, il va, souvent au culot, courir les cabarets pour s’imposer au chant, servir d’homme à tout faire à Edith Piaf (dommage, pas de Marion Cotillard ici pour interpréter “La Môme” mais Marie-Julie Baup est très bien aussi) avant de tout jouer à quitte ou double en allant chanter aux Amériques.
De fil en aiguille, le succès se dessine à force de rencontres prometteuses comme celle avec Johnny, pour qui il va écrire “Retiens la nuit”, avant à son tour de connaître la gloire en 1960 avec le titre emblématique “Je m’voyais déjà”. « Le film, je l’espère, permet de comprendre ses sacrifices, son immense engagement dans le travail – on sait qu’il travaillait dix-sept heures par jour – et favorise l’empathie à son égard, notamment grâce au jeu de Tahar Rahim, assure encore Fabien Marsaud. Charles savait ce qu’il voulait. Atteindre ses objectifs en tant qu’artiste lui a beaucoup coûté et l’a souvent éloigné des siens, ce qui ne l’a pas empêché d’être très généreux avec tous. » « Il y a forcément quelque chose qui résonne en nous dans la vie de Charles Aznavour, poursuit Mehdi Idir. Le courage, il nous en a aussi fallu pour parvenir à faire des films, alors que personne ne nous attendait sur le terrain du cinéma. Les dialogues et situations du film sont émaillés de clins d’œil à nos existences personnelles. Pour écrire les relations de Charles avec sa famille ou avec Pierre Roche, nous nous sommes inspirés de souvenirs avec nos proches. Nous nous sommes rendu compte que nous nous ressemblions sur plusieurs points, comme le côté passionné ou obsessionnel. »
Cinq chapitres comme autant de chansons.
Malgré son riche passé familial et des parents proche du héros de la résistance communiste Missak Manouchian, Charles Aznavour ne s’est jamais vraiment engagé politiquement. Pourtant, dans certaines chansons, des thèmes forts résonnent, comme la pauvreté bien sûr mais aussi le génocide arménien ou l’homosexualité. Cela donne lieu à quelques séances très émouvantes. « Charles a pris position dans son œuvre, comme en témoignent “Ils sont tombés” ou “Comme ils disent”, par exemple, poursuit Fabien Marsaud. Pour nous, débuter le film par ces images de génocide et le conclure par la voix de Claire Chazal, qui souligne qu’Aznavour, fils d’immigrés et d’apatrides, est devenu l’un des symboles de la culture française, c’est forcément un geste politique. Cette phrase n’est pas un commentaire de journaliste que nous avons repris, elle est de nous et nous avons demandé à Claire Chazal, qui a parlé à tant de Français pendant tant d’années, de la lire. »
En cinq chapitres comme autant de chansons, la vie de Charles Aznavour est racontée avec majesté en montrant et soulignant l’ambition démesurée d’un homme qui donnera tout pour conquérir le monde, au sens propre.
Le film ayant été validé dans sa conception par Charles Aznavour lui-même, le contraire eu quand même été étonnant mais le résultat s’affirme comme un nouveau pari réussi pour l’équipe du film. “Mr Aznavour” devrait sans trop de problèmes rencontrer son public.
Patrick Auffret